L'habit ne fait pas le moine
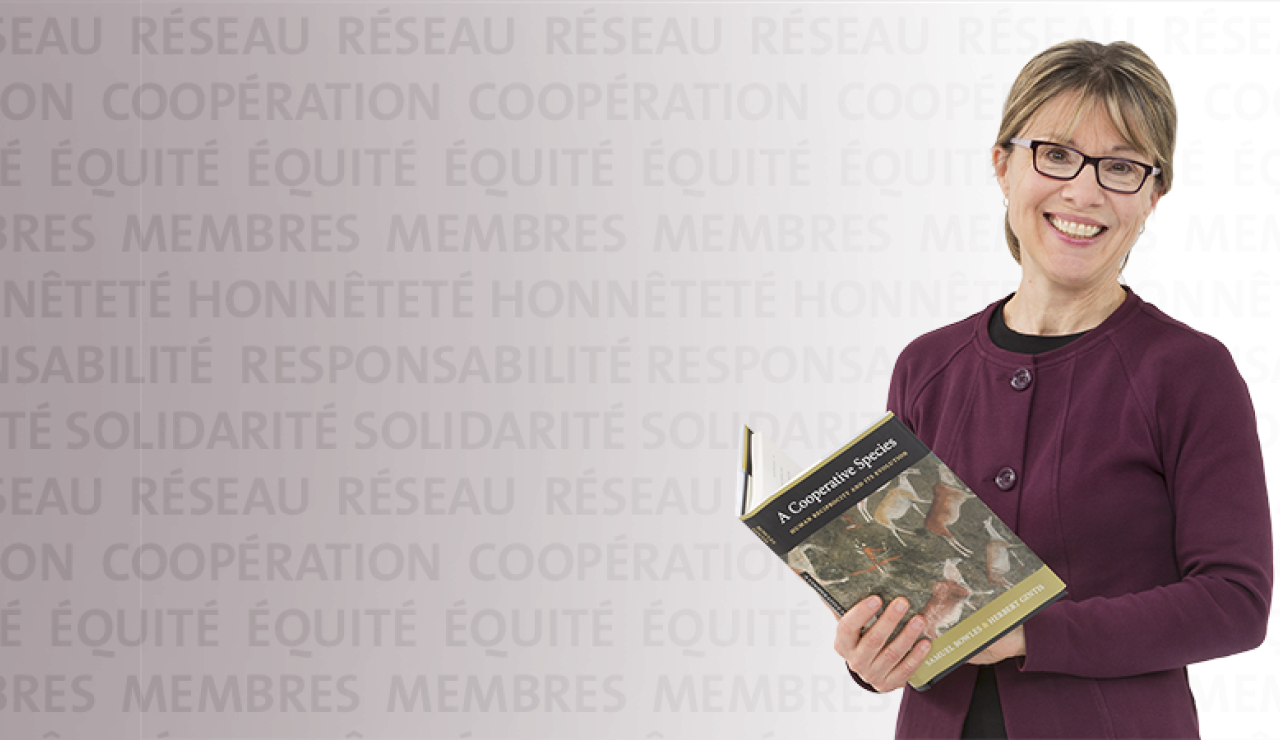
Lire toutes les « Pause-Pensée »
Archives
Comme la plupart des gens, j’ai un préjugé favorable à l’endroit des coopératives. Bien des sondages l’ont démontré : intuitivement, même sans les connaître intimement, les gens font confiance aux coopératives.
« C’est une coopérative, ça doit être du bon monde », qu’on se dit. Mais attention, la formule coopérative n’est qu’un véhicule qui permet le regroupement de gens qui croient qu’ensemble ils répondront mieux à leurs besoins que s’ils s’y prennent tout seuls, de façon isolée.
Or ces besoins, à l’origine d’un regroupement, sont extrêmement variés et conduisent à la création d’une incroyable diversité de coopératives. Je me rappelle l’histoire du Lusty Lady, à San Francisco. J’avais vraiment été surprise de découvrir que ce bar de danseuses nues avait été racheté par les employées, en 2003, et qu’elles l’avaient exploité jusqu’en 2013 comme coopérative de travailleuses. Bien que j’aie des réserves sur ce genre de commerce qui mise sur l’exploitation du corps des femmes, j’aime à penser que, grâce à la formule coopérative, les travailleuses du Lusty Lady ont pu se donner de meilleures conditions de travail.
Plus récemment, j’ai appris qu’en France des mutuelles d’un nouveau genre sont mises sur pied – sans enregistrement officiel, mais avec toutes les fonctions et règlements d’usage… et même des sites Web. Ce sont des mutuelles de fraudeurs de transport en commun! Elles poursuivent une mission à la fois économique et politique. Considérant que les transports publics devraient être gratuits afin de permettre à tous de circuler librement à l’intérieur de la ville, des gens se regroupent afin de mutualiser le risque d’avoir une amende quand ils prennent le transport en commun sans payer. Les membres paient une cotisation mensuelle minime et lorsque l’un d’entre eux écope d’une amende, la mutuelle le rembourse. Apparemment, ça vaut vraiment le coup!
C’est clair : on est ici dans la désobéissance civile. On ne s’en cache pas, avec des noms comme « Mutuelle de fraudeurs de la région parisienne », « Mutuelle de fraudeurs de Lille »… On peut revendiquer la gratuité des transports, mais est-ce légitime d’enfreindre les règlements de sa propre municipalité en guise de protestation? Belle question, à laquelle on ne peut répondre que par la grille de son éthique personnelle.
Cette réflexion en rejoint une autre, inspirée par Richard Sennett, enseignant à la London School of Economics et à l’Université de New York. Dans son livre Ensemble : Pour une éthique de coopération, il parle de la collusion. Qu’est-ce, au juste, que la collusion? N’est-ce pas une forme de coopération, une coopération secrète entre quelques personnes dans le but de nuire à un tiers? Eh oui, c’est tout à fait cela! Ça donne à réfléchir...
Conclusion : l’habit ne fait pas le moine. Il ne suffit pas de crier « coopération » pour s’affranchir de tout questionnement. Car l’acte de coopérer se définit toujours avec un complément de circonstance. Pourquoi coopérer? Dans quel but? Voilà les questions qu’il faut se poser. Bien entendu, les sociétés coopératives légalement constituées ont déjà subi un premier filtre car quand on veut obtenir des statuts officiels, il faut indiquer clairement le but de l’entreprise. Cela permet d’évacuer, directement à la source, tout ce qui relève de l’illicite.
Mais, rappelons-le : tout ce qui est légal n’est pas nécessairement éthique. Et vice-versa. Nous voici donc dans le champ nébuleux de l’éthique, là où règnent en maîtres nos valeurs personnelles, celles qui établissent nos limites. Et c’est là, au plus profond de nos tripes, que se joue la bataille de l’acceptabilité… ou du rejet. En définitive, la réflexion éthique aura toujours sa place. Elle nous invite à revoir nos valeurs et à développer la pensée critique – un exercice salutaire, qui mène à une meilleure connaissance de soi, pour une meilleure interaction avec les autres.










