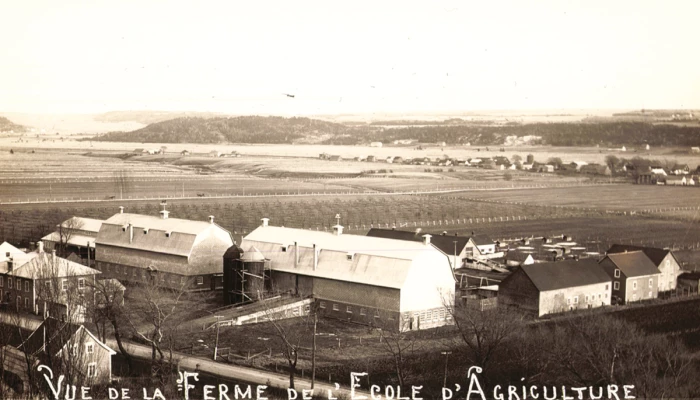Les agronomes discutent de gestion de l’offre
Les présidents des Éleveurs de volailles, des Producteurs d’œufs et des Producteurs de lait ont participé à un panel de discussion sur la gestion de l'offre.

Auteurs de contenu
Le 11 novembre dernier, l’Ordre des agronomes du Québec consacrait son congrès au thème « Agronomie et économie, un équilibre à cultiver ». En après-midi devant 827 personnes, le journaliste agricole, collaborateur du Coopérateur et agronome, Nicolas Mesly, et l’enseignant, agronome, et chroniqueur au Coopérateur, Pascal Thériault, ont animé un panel de discussion regroupant les présidents de trois fédérations spécialisées québécoises dont les productions sont sous gestion de l’offre : Benoît Fontaine des Éleveurs de volailles, Sylvain Lapierre des Producteurs d’œufs et Daniel Gobeil des Producteurs de lait.
Revenus sous gestion de l’offre
Les coanimateurs ont mis la table en rappelant que 60 % des revenus des fermes ontariennes et québécoises proviennent des productions sous gestion de l’offre et que la valeur des quotas atteint une valeur monumentale de 48 milliards $, somme qui se rapproche des ventes mondiales de la multinationale John Deere, image Nicolas Mesly. Or, la gestion de l’offre, qui accuse plus d’un demi-siècle d’existence, est défendue par des agriculteurs au poids démographique décroissant.
Moment pédagogique, Mesly et Thériault ont demandé aux présidents de rappeler que représentaient les quotas. Dans le poulet, le quota s’exprime en mètre carré pour y élever plus ou moins 33 kg par lot. Il se négocie à 2100 $/m2, explique Benoît Fontaine, un prix 50 % plus cher en Ontario. Dans les œufs, le quota est rapporté par poule. Sylvain Lapierre souligne que le Québec a plafonné le prix par poule, le plus faible au Canada (245 $), l’Ontario étant à 391 $, l’Ouest canadien atteignant 600 $. Dans le lait, l’étalon de mesure est le kilo quotidien de matière grasse. Ici aussi, le prix est plafonné à 24 000 $ alors qu’il monte entre 35 000 et 50 000 $ dans les provinces de l’Ouest.
Gestion de l’offre et endettement
La très grande valeur des quotas participe-t-elle à une sorte d’effet de levier financier qui risque d’aggraver l’endettement? Pour Benoît Fontaine, la gestion de l’offre, système solide, ne crée pas de faux sentiment de sécurité chez les éleveurs. Les producteurs font consensus : si les institutions prennent le quota en garantie, la capacité de remboursement prévaut. Dans les trois productions, la demande surpasse largement l’offre. « Il n’y a qu’en moyenne 5000 poules à vendre par année », illustre Sylvain Lapierre. Dans le poulet, Benoît Fontaine chiffre entre 1 et 3 % les transactions de quota via le système de vente centralisée. Du côté du lait, Daniel Gobeil soulève que hormis les terres et le quota, les producteurs laitiers ont, entre 2020-2024, investi plus de 650 millions $ dans leurs fermes, preuve que les investissements ne vont pas qu’à cet actif immatériel.
Question de relève
Et l’accès à la relève? Toutes les fédérations ont des programmes d’aide à la relève. Benoît Fontaine se montre curieux de connaître l’accès à la relève aux productions non contingentées. Lui-même producteur sans relève apparentée, il a fait de la place à deux jeunes en « laissant de l’argent sur la table ». Dans le poulet, le quota est figé dans deux blocs : est et ouest du Québec. L’aviculteur pense que la gestion de l’offre n’accélère pas la concentration et la consolidation des fermes, un phénomène en branle depuis des décennies, stipule Daniel Gobeil. Au contraire, la répartition territoriale du quota vitalise des villages de régions éloignées et diminue la pression des maladies.
Dans les œufs, où la diminution du nombre de fermes inquiétait au tournant des années 2000, une soixantaine de fermes ont été lancées depuis et sont toujours en activité – certaines opèrent même un transfert à une deuxième génération, expose Sylvain Lapierre. La moitié des nouvelles allocations provenant de la croissance naturelle du marché sont dédiées aux fermes de petite taille de manière à réduire l’écart avec les plus grandes fermes. « Les producteurs ne peuvent plus s’acheter les uns les autres », assure-t-il.
La menace Trump
La guerre commerciale initiée par le président Trump n’augure rien de bon pour la gestion de l’offre, fut-elle enchâssée dans la loi fédérale C-202. Comme le fait remarquer Nicolas Mesly, 20 % des revenus des agriculteurs étatsuniens dépendent des exportations. Benoît Fontaine émet un bémol : même si 10,5 % du marché a été concédé, les contingents permettent de réguler les marchés et de combler des besoins spécifiques des marchés intérieur et extérieur en viande blanche, brune, ailes et abats. « Les États-Unis aiment quasiment la gestion de l’offre, ironise l’éleveur, pour qui le lobby avicole étatsunien est satisfait des contingents d’exportation actuels. N’oublions pas que chaque pays a ses produits sensibles : le sucre aux États-Unis, le riz au Japon. »
« Sans la gestion de l’offre, il n’y aurait pas de production d’œufs au Québec, s’exclame Sylvain Lapierre, qui ajoute que 60 % des poules aux États-Unis sont encore en cages conventionnelles alors que les normes ici évoluent vers de meilleures normes de bien-être animal. L’homme prévient que les producteurs d’œufs étatsuniens, dont certains ont à eux seuls plus que la taille du marché canadien, pourraient approvisionner facilement le marché d’ici, mais l’auraient-ils fait quand frappait la grippe aviaire ou auraient-ils privilégié leurs consommateurs? Sylvain Lapierre évoque l’occupation dynamique du territoire, la sécurité alimentaire et les prix stables pour les producteurs et les consommateurs pour justifier le maintien des quotas dans notre contexte nordique.
Inversement, quand il manquait d’œufs au sud de la frontière au printemps 2025, le Canada ne s’est pas précipité pour faire des affaires d’or, en cohérence avec la limitation de la production que s’impose l’aviculture canadienne. N'empêche, avec nos terres, notre eau et notre expertise, pourquoi ne pas profiter du marché mondial, s’interroge Nicolas Mesly. Serait-on suffisamment compétitifs, rétorquent les panélistes. « L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont axé leur production laitière sur le marché mondial, mais les bas prix mondiaux ralentissent leurs exportations », relève Benoît Fontaine.
Dans le lait, le Wisconsin et la Californie, qui pourraient inonder le marché canadien, jalousent notre système, estime Daniel Gobeil, car il fonctionne à 100 % avec les revenus du marché, sans subvention, chose importante dans un contexte de déficits budgétaires records des gouvernements fédéral et provincial. Le producteur ne se berce pas d’illusions : ayant concédé 18 % du marché intérieur dans les accords commerciaux récents, la croissance du marché, à 1 ou 2 %, est anémique. La concession-compensation a montré ses limites. « Il faut réaffirmer qu’en 2026, un examen de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique est prévu, pas une renégociation », indique-t-il, mentionnant aussi la réciprocité des normes sociales et environnementales, plus élevées ici qu’au sud.
Gestion de l’offre et productivité
Et la critique comme quoi la gestion de l’offre nuirait à la productivité? Elle est balayée du revers de la main. « Comme producteur, on veut battre le modèle du coût de production, rappelle Sylvain Lapierre. Si on le bat, une nouvelle enquête capte les gains d’efficacité et refile les bénéfices aux consommateurs. »
Dans ce contexte de gestion de l’offre sous pression, qu’attendent les producteurs des agronomes? Daniel Gobeil mentionne la recherche agronomique et les laboratoires vivants pour améliorer l’analyse de cycle de vie du lait d’ici, à l’empreinte carbone parmi les plus faibles dans le monde. Benoît Fontaine compte sur des agronomes sur le terrain, qui comprennent les inquiétudes face à la gestion de l’offre. Sylvain Lapierre voit dans ceux-ci des alliés et des professionnels pour aider à être meilleurs.