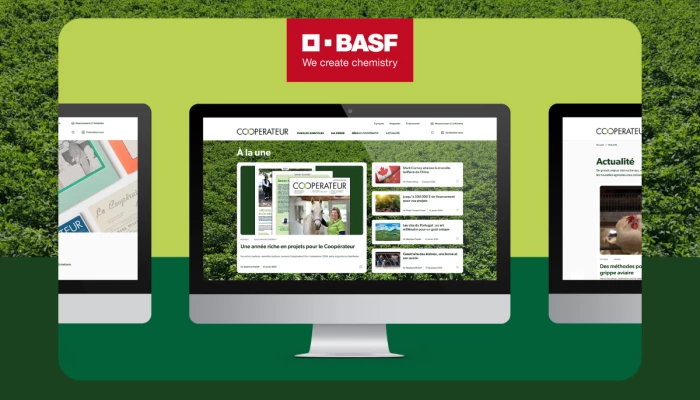Derrière la naissance de Sollio Groupe Coopératif
Retour historique sur la création de Sollio Groupe Coopératif avant 1922.

Auteurs de contenu
Le 31 octobre 1922, près de 200 personnes se retrouvent à la salle de la Cour du recorder (l'ancêtre de l'actuelle Cour municipale) dans l’hôtel de ville de la Ville de Québec pour officialiser la fusion de trois coopératives. Ils donnent alors naissance à la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, connue depuis 2019 sous le nom de Sollio Groupe Coopératif.
Cette démarche a été précédée de mois de consultation, d’aller-retour entre les trois coopératives : la Société coopérative des fromagers de la province de Québec, le Comptoir coopératif de Montréal et la Société coopérative agricole des producteurs de semences de Québec. En outre, on ne peut sous-estimer le rôle de déclencheur de ce processus de fusion qu’a joué à ce moment précis de l’histoire le ministre de l’Agriculture, Joseph-Édouard Caron. Pour lui, le regroupement de ces trois coopératives qui jouent un rôle de grossiste dans une seule entité serait un atout pour les cultivateurs de tout le Québec. Bien qu’à l’évidence, il ait forcé le processus de fusion, avec le recul, on ne peut que lui donner raison sur la vision.
Cependant, en y regardant de plus près, sur quelques décennies, au moins trois grands facteurs ont aussi contribué à cette naissance.
1. Les besoins de base
En lisant sur la situation des cultivateurs au XIXe siècle, force est d’admettre qu’ils n’ont pas un sort enviable. En quelques mots, ils sont souvent sous l’emprise d’intermédiaires qui écument les campagnes dans le but de gagner de l’argent sur leur dos. Que ce soit sur le plan de l’approvisionnement à la ferme ou de l’écoulement de la production, dans le premier cas, l’objectif est de faire payer le plus cher, dans le second, de payer le moins cher. Il faut donc mettre un terme à ce système d’exploitation qui maintient l’agriculture dans un état de sous-développement. Le mode coopératif va le permettre, car il ne carbure pas à la maximisation des profits et il est sous le contrôle des principaux intéressés.
2. La recherche de la qualité
Toujours au XIXe siècle, le Québec ne se démarque pas par la qualité de sa production, notamment en matière de fromage, alors que la demande pour le cheddar est en forte croissance, entre autres durant la guerre de Sécession aux États-Unis (1861-1865), ainsi qu’en Angleterre au cours de la même période. Quelques personnes visionnaires et très déterminées vont promouvoir un virage qualité. Sur quelques décennies, Édouard-André Barnard (1835-1898) est ainsi au front. L’espace ne permet pas de lui rendre un témoignage à la mesure de ses contributions, mais soulignons trois faits d’armes. Il fait campagne pour l’établissement de fermes laitières modèles depuis le début des années 1870.
En 1881, il fonde une fabrique-école de beurre et de fromage à Saint-Denis-de-Kamouraska. Enfin, l’année suivante, il est au cœur de la constitution de la Société d’industrie laitière. Mentionnons que depuis des années, dans le jardin de la Maison Chapais, à Saint-Denis-De La Bouteillerie, il est possible de faire un bref parcours découverte qui retrace l’histoire de la fabrique-école portée en ce lieu par Barnard. Ce travail sur la qualité de la production est aussi l’œuvre des écoles d’agricultures naissantes, dont la toute première, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en 1859. L’abbé François Pilote est derrière cette initiative, lui qui a voyagé en Europe pour s’inspirer des meilleures pratiques à l’époque. Deux autres écoles verront le jour, celles de Saint-Hyacinthe et d’Oka, fondées à un an d’intervalle, en 1892 et en 1893.
3. La valeur de l’action collective
Ce n’est pas d’hier que l’action collective est valorisée en milieu rural. En fait, on pourrait littéralement remonter à l’époque de la Nouvelle-France. Ainsi, la corvée seigneuriale se traduit par des corvées de voirie, soit la contribution des censitaires pour l’entretien du chemin qui passe sur le domaine seigneurial, pensons ici au chemin du Roy le long du fleuve Saint-Laurent.
Cependant, très tôt, les cultivateurs ont développé l’habitude du coup de main ou de l’entraide avec les voisins, un geste de solidarité nécessaire dans un contexte où la survie est parfois en jeu selon les conditions de météo ou une épreuve, tels un incendie, un accident ou la maladie, voire la mort, mais aussi simplement par souci de bon voisinage. Ce sont aussi des travaux à la ferme, comme les moissons ou le broyage du lin (prononcé brayage) et, parfois, des corvées alimentaires, on pense à l’épluchette de blé d’Inde, à la préparation des conserves ou aux boucheries.
L’action collective va se porter rapidement dans le domaine de l’assurance. Inspirées d’expériences similaires aux États-Unis et en Angleterre, dans les années 1830 se mettent en place, entre autres en milieu rural, des sociétés de secours mutuel pour se prémunir contre les aléas de la vie, notamment le feu. D’ailleurs, la plus vieille de ces sociétés encore en activité est constituée en 1852 à Huntingdon, en Montérégie, sous le nom de Compagnie d’assurance mutuelle contre le feu du comté de Beauharnois. En 2025, elle porte le nom de Promutuel Assurance du St-Laurent aux Appalaches, une des mutuelles membres du Groupe Promutuel. Ces sociétés de secours mutuelles vont se multiplier en milieu rural, que ce soit sur une base de comté, de municipalité ou de paroisse. À partir du début du XXe siècle, on relève la création de mutuelles-incendie destinées à des secteurs d’activités économiques précis, dont les beurreries et fromageries.
Vers les années 1860, deux actions originales de type collectif se démarquent de nouveau en milieu rural : des syndicats de producteurs et des cercles agricoles. Ainsi, les syndicats composés de propriétaires de fabriques de beurre et de fromage et d’autres établissements laitiers mettent sur pied un service d’inspection et un service de professeurs visiteurs pour assurer la diffusion de nouvelles techniques. Par ailleurs, souvent à l’initiative d’agronomes, la formation des cercles agricoles à partir de 1862 permet de rejoindre plus facilement les cultivateurs, car ces regroupements ne sont plus à l’échelle d’un comté comme le sont les sociétés, mais de la paroisse. Le gouvernement reconnaît ce rôle prédominant des cercles par l’adoption d’une loi en 1893.
Enfin, inspirée de nouveau d’expériences étrangères, mais aussi de ce qu’un certain Alphonse Desjardins fait dans le domaine de l’épargne et du crédit, en 1903, à Adamsville, dans ce qui est aujourd’hui la municipalité de Bromont, la première coopérative agricole est créée par le curé J.A.B. Allaire. Le terrain était mûr pour matérialiser l’idée : en 1920, on dénombre plus de 300 coopératives agricoles!
Cet article est paru dans le Coopérateur d'avril 2025.